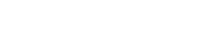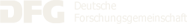Chère amie, je vous ai écrit hier en réponse à vos lignes du 31; j’écris aujourd’hui uniquement pour que vous ne voyez aucun courrier sans nouvelles, car la letre que vous m’avez promise ne peut arriver qu’après le départ de celle-ci. Les lettres de Munich que vous m’avez envoyées n’avoient aucun rapport avec les ouvertures dont je vous ai parlé, elles étoient de vieille date.
Je vous enverrai demain par le fourgon le livre de Frédéric. Si j’avois pu prévoir qu’on s’arracheroit comme cela les exemplaires, j’en aurois apporté plusieurs. M. Meister m’a aussi forcé la main pour lui céder celui qui étoit destiné pour son neveu. Il s’en fit d’autant moins scrupule que l’idée de le traduire pour la France lui parut impossible après l’avoir lu, il étoit extrêmement frappé de la profondeur et de la piquante nouveauté de cet ouvrage. Il paroît qu’il produit partout cet effet. Nous avons su à Vienne qu’il avoit déjà pénétré à Hambourg malgré la censure. A Berlin on s’en occupoit fortement à la cour; autrefois un tel livre y auroit été l’objet de la réprobation générale, et on l’auroit considéré comme insensé; il semble pourtant que les leçons des événements changent peu à peu les idées des gens.
Frédéric vous présente aussi par moi un bel exemplaire de la traduction de Corinne qu’il n’a jamais eu l’occasion de vous faire parvenir; je la crois bien faite, elle a été lue beaucoup.
J’ai été à Vienne comme si je n’y étois pas. Je n’ai été ni au théâtre ni même chez Casperle, ni au Prater, ni aux fêtes populaires dont il y a beaucoup dans ce pays de Cocagne, ni à la biblothèque, ni aux galeries de tableaux. Je ne voulois soustraire aucun moment à la société qu’il pouvoit m’être utile de voir. Je n’ai même pas eu le tems de lire plusieurs brochures de Frédéric, faites avant la guerre et qui n’ont jamais vu le jour.
Faites-moi savoir le séjour actuel de M. de Balk et son adresse. Si Mlle Randall se rappelle le nom de ce bon excellent homme d’Amboise qui nous apportoit des manuscrits de St-Martin, elle m’obligeroit infiniment en me le donnant. C’est pour obliger M. Bader que j’ai beaucoup vu et qui m’a pris en singulière amitié – il faisoit un peu auprès de moi le missionnaire de ses mystères. C’est un singulier franc-maçon théosophe, qui réunit à son penchant pour les hautes sciences une grande habileté dans les affaires de ce monde. Il négocioit avec le gouvernement pour abandonner sa place en Bavière et se fixer en Autriche. Il a fait une découverte chimique fort importante pour la fabrication du verre; il proposoit d’acheter des terres en Bohème pour l’exécuter en grand, mais en demandant des avantages considérables.
Je me suis mal exprimé sur le compte d’Adam Muller. Il n’a pas été renvoyé de Berlin, mais on l’a voulu employer et il ne pouvoit pas s’accorder avec la direction qu’on suivoit – il a donc eu la permission de voyager jouissant d’une pension. M. de Hardenberg l’avoit très fortement recommandé au comte de Metternich. Depuis que vous l’avez vu il a publié deux ouvrages, l’un intitulé «Eléments de la politique», l’autre «Sur la Prusse». Je n’ai pas encore eu le tems de les lire, mais Genz et même Fréd[éric] en font de grands éloges. Je ne m’étonnerois pas de le voir placé en Autriche.
Comme Vienne est aujourd’hui un port où toute espèce de personnes naufragées abordent, j’ai rencontré encore M. Beyme, Excellence déchue et qui, même dans les tems de sa splendeur, ressembloit à un barbier galant qui se mêle un peu de chirurgie. On l’a peu vu, dans sa détresse il s’est accroché à Frédéric qu’il a recherché de toutes les façons. Singulières vicissitudes, quand je me figure de quelle hauteur autrefois un tout-puissant secrétaire du Cabinet à Berlin nous regardoit, nous autres, écrivains de la nouvelle école!
Frédéric a obtenu la permission de donner l’hyver prochain un cours sur l’histoire de la littérature.
Il ne me convient guère que vous preniez la voiture, je ne puis pas avec vous faire un prix de juif comme je l’avois compté faire avec d’autres et toutes mes spéculations de gain s’en vont en fumée. J’en aurois pourtant eu besoin pour réparer mes pauvres hardes, qui ont été terriblement avariées par la manière dont je voyageois en allant.
Si vous me permettez d’aller à Berne, j’irai dans la calèche pour l’avoir plus près; j’ai déjà manqué un voiturier qui s’en retournoit à vuide avec ses chevaux et qui m’auroit mené pour peu de chose.
Un voyageur de Berne m’a dit que Villers étoit sorti triomphant de son affaire, et que son persécuteur en avoit eu une réprimande. J’aurois cependant eu à sa place une grande aversion pour les démarches qu’il a du faire pour cela. On dit que c’est sa correspondance particulière par laquelle il s’est compromis.
Vous avez dit que rien ne se compare aux troubadours françois ou provençaux, phrase que Frédéric n’a jamais pu vous pardonner et contre laquelle j’ai vainement réclamé. Nous soutenons que nos troubadours non seulement peuvent leur être comparés, mais qu’ils les surpassent de beaucoup. Je vais vous traduire une strophe d’un poème épique, fait à la gloire des ordres chevaleresques, principalement des Templiers, et qui voile sous des allégories des mystères qu’ils prétendoient posséder. Voici la strophe:
« L’amour embrasse dans son enceinte ce qui est étroit et ce qui est vaste. Il a sa demeure sur la terre, et dans le Ciel il se présente pur devant Dieu son protecteur. L’amour est partout excepté aux enfers. Mais les forces de ce puissant amour languissent dès que le doute et l’inconstance s’y associent.»
Que dites-vous de cela ? N’est-ce pas d’une profondeur sublime?
Adieu, chère amie, vous me dites bien peu sur vous-même et sur ce qui vous entoure. Donnez-moi donc une idée du château de C[oppet] tel qu’il a été depuis mon absence, et dites beaucoup de choses de ma part à tous ceux qui se ressouviennent encore de moi.