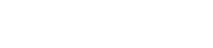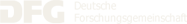Vous me blessez en me parlant d’argent avec cette régularité, cher ami; vous savez que tout mon bonheur dans ce monde consiste à vous ravoir chez moi; ainsi, quand vous prenez de l’argent, c’est comme si vous me disiez: je reviens. Ainsi, ne vous gênez pas; et si vous voulez une autre lettre de crédit, mandez-le moi sans gêne, et songez que c’est une déclaration d’attachement que de tirer sur moi.
Combien j’admire notre Prince! ne pouvez-vous pas le lui dire? n’avez-vous pas un moment pour me mettre à ses pieds? on parle de lui ici avec transport; mais dites-lui en mon nom de ne pas oublier la France. C’est sur les bords du Rhin qu’il doit être, lui et Moreau tout ensemble. Quelle douleur que son sort! je soigne sa pauvre femme, et j’ai pour elle une pitié déchirante; nous ne savons pas encore s’il vit ou non; il a écrit une lettre à sa femme depuis son malheur, qui est historiquement belle; je vous l’envoie de la main d’Albertine. Je vous répète ce que je vous ai dit déjà: si l’Allemagne est libre, j’irai y vivre après que vous aurez passé quelque temps ici avec moi. Soignez Baudissin: je ne vois rien ici qui le vaille pour Albertine, et cela s’arrangera mieux avec mes projets de Berlin; mais, hélas! ne va-t-il (Napoléon) pas se lancer contre vous dans toute sa force! veillez sur le Prince; empêchez qu’il ne s’expose; et vous-même, cher ami, prenez garde, et revenez-moi: l’hiver serait trop rude pour vous. Que je vous serve de raison et de prétexte, si vous sentez que cela ne vous convient pas.
Pauvre Albert! quelle carrière il a manquée! ne payez plus aucune de ses dettes; renvoyez tout à moi, purement et simplement, en disant que cela ne vous regarde plus. Signeul est surtout le dernier des hommes que je croirais à cet égard. J’attends avec anxiété votre réponse sur le départ d’Auguste: il désire oui; moi je le crains; mais j’ai sa parole au moins qu’il ne servira pas militairement. Il devrait prendre votre place; et vous, revenir.
Je quitte ceci dans huit jours; je reste huit jours à Londres, et je vais passer trois semaines chez le marquis de Lansdowne, où vos lettres m’arriveront douze heures plus tard, et voilà tout.
J’admire ce pays; à quelques égards, je m’y plais; mais il faut en être pour le préférer à tous les autres: nos habitudes continentales valent moins, mais nous conviennent mieux. Ce qui est admirable, c’est la sécurité, la liberté et les lumières. Lire est ici une chose nouvelle, tant il y a de vie dans les écrits; celle qui n’est pas dans la société se trouve dans les voyages, les histoires, etc.; et puis les gazettes à present sont attendues comme un voyageur. Mais les vents font une prison de la belle île, quand an attend de vos nouvelles à tous.
Adieu, cher ami, adieu; revenez-moi, comptez sur moi; car j’ai appris, mieux que je ne le savais encore, que vous êtes incomparable. Songez que nous sommes votre famille, et ne relâchez jamais ces liens que le bon Dieu vous a donnés. Parlez de moi à Camps, dites-lui qu’il est chargé de veiller sur notre Prince, et qu’ainsi ce sera lui qui sauvera le monde. Adieu, ami de mon âme, adieu.
Mon malheur s’est changé en abattement: que j’aurais besoin de vous!