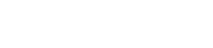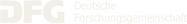Vous avez annoncé, dans l’avant-propos de la Bibliothèque italienne, l’intention vraiment libérale d’insérer dans ce journal les objections qui vous seraient présentées contre les opinions énoncées par les auteurs des différents articles. Je prends donc la liberté de vous communiquer quelques observations concernant l’écrit de M. le comte Cicognara sur les fameux chevaux de bronze de la basilique de Saint-Marc, dont Venise se voit de nouveau embellie par les soins paternels de l’empereur d’Autriche. M. de Cicognara est d’avis que ces chevaux n’aient point été transportés de la Grèce à Rome, mais exécutés dans cette capitale même du temps de Néron. Cette opinion n’est pas neuve, elle a été développée par le commentateur des statues de Saint-Marc, Zanetti, quoique d’une manière moins positive. Il se peut qu’elle soit fondée, mais M. de Cicognara l’appuie sur des arguments qui ne sauraient être admis, et que cependant I’auteur de l’extrait, dans le premier cahier de la Bibliothèque italienne, a laissé passer comme valables.
Les Grecs n’érigeaient point d’arcs de triomphe, dit M. de Cicognara, donc ils n’avaient point d’emploi pour des quadriges de bronze, tandis que les Romains surmontaient d’ordinaire les arcs de triomphe, si fréquents chez eux, de chars attelés de quatre chevaux de front, comme l’attestent les médailles.
Soit: les Grecs, tant que dura leur indépendance, n’érigèrent point d’arcs de triomphe à la gloire des vainqueurs, puisque l’usage du triomphe leur était étranger. Cependant ils bâtissaient sans doute de beaux portails aux places publiques et aux enceintes sacrées. Mais laissons de côté les arcs de triomphe; ne dirait-on pas, d’après le raisonnement de M. de Cicognara, que les quadriges eussent été affectés exclusivement à ce genre d’édifices? Il y avait des emplacements convenables pour ce magnifique ornement sur les temples et autres monuments publics. D’ailleurs un quadrige n’était pas nécessairement l’accessoire d’un édifice: il pouvait être place tout simplement sur un piédestal comme une statue équestre; et je prouverai qu’on voyait en Grèce beaucoup de quadriges ainsi isolés.
Dans les temples grecs d’une certaine grandeur, on ménageait souvent un plan horizontal derrière le sommet du fronten, pour y placer une statue. Une Victoire dorée brillait sur le faîte du temple de Jupiter à Olympie. En ce moment je ne me rappelle point d’exemple grec d’un quadrige placé de cette manière. Néanmoins l’existence de cet usage dans l’antiquite ne saurait être contestée. Deja Tarquin l’Ancien fit surmonter le temple de Jupiter Capitolin d’un quadrige en terre cuite. Tarquin, selon Tite-Live, était Grec d’origine, et sans entrer ici dans la question de savoir si son père, le Corinthien Damaratus, a été le premier à introduire les arts du dessin en Étrurie, it faut admettre, je pense, que les Étrusques ont eu des communications actives avec la Sicile et la Grande-Grèce, et que leurs artistes, employés par Tarquin, auront imité les Grecs dans cet ornement comme dans beaucoup d’autres choses1.
Le célèbre quadrige conduit par le Soleil, que Lysippe avait fait pour les Rhodiens, couronnait probablement la cime du temple de cette divinité. On ne saurait le supposer placé dans l’interieur; et quel emplacement plus digne de ce char lumineux que celui où il semblait, pour ainsi dire, planer dans les airs?
Le tombeau de Mausole se terminait par une pyramide qui, se rétrécissant de gradin en gradin, laissait en haut un espace carré, où se trouvait un quadrige de marbre, ouvrage de Pythis. Le massif de cette pyramide pouvait facilement porter le poids énorme de quatre chevaux de pierre, peut-être de grandeur colossale; mais sur les temples an aura préféré les chars de bronze à cause de leur légèreté.
L’art de jeter des chevaux en bronze fut cultivé en Grèce de très-bonne heure. Je puis citer deux chars de cette matière antérieurs au siècle de Périclès, c’est-à-dire à cette époque décisive où les artistes grecs commencèrent à rivaliser entre eux de grandeur dans leurs conceptions, et les peuples de la Grèce de magnificence dans leurs projets d’embellissements sacrés et profanes.
Hérodote parle d’un quadrige de bronze, attelé de quatre juments, qui était placé à Athènes près de l’entrée des Propylées à gauche. Les Athéniens y avaient consacré la dîme de la rançon des prisonniers faits dans une guerre contre les Béotiens et les Chalcidéens. Cette guerre eut lieu dans la 68ème Olympiade, ce qui nous donne à peu près la date de l’ouvrage.
Le char de Cléosthène, vainqueur aux jeux olympiques dans la 66ème Olympiade, devait être du même temps, ou même un peu plus ancien. On y avait observé l’antique usage de mettre des inscriptions sur les statues mêmes: les noms des chevaux étaient gravés sur leurs flancs. Pausanias n’indique pas la matière dont ce quadrige était formé, mais puisqu’il était l’ouvrage d’Agéladas, maître de Myron et de Polyclète, il aura été sans doute de bronze.
Veut-on des exemples de quadriges qui n’appartenaient à aucun édifice, et qu’on avait posés sur un simple piédestal? A en juger d’après les expressions d’Hérodote et de Pausanias, le char ci-dessus mentionné, placé à l’entrée des Propylées, était de ce nombre. Évidemment tous les chars des vainqueurs aux jeux olympiques et pythiques, ou d’autres personnes mémorables, placés dans l’Altis, c’est-à-dire le bois sacré de Jupiter à Olympie, et dans l’enceinte sacrée à Delphes, doivent être rangés dans cette classe. Dans la description de Pausanias je n’en compte pas moins de sept à Olympie, dont quatre de bronze, et deux à Delphes. Cependant Pausanias passe sous silence beaucoup d’objets, et ne parle que des ouvrages d’artistes renommés, ou de monuments qui lui donnaient lieu d’éclaircir quelque circonstance historique.
Ces faits prouvent déjà que les quadriges de bronze n’étaient rien moins que rares en Grèce. Mais en parcourant les notices que nous fournit Pline, en voit encore bien autre chose. Il ne cite pas moins de sept statuaires ou artistes qui travaillaient en bronze, tous célèbres pour la beauté de leurs biges et de leurs quadriges: à la tête de tous Calamis, contemporain de Phidias, ensuite Aristide, l’élève de Polyclète, Euphranor, Ménogène, Lysippe, son fils Euthycrate, et Pyromaque. Tous ces artistes ont fleuri dans la grande époque de l’art, c’est-á-dire depuis Ia 80ème jusqu’à la 120ème Olympiade. Pline désigne en particulier quelques-uns de leurs ouvrages dans ce genre par les statues qui étaient placées sur les chars: mais la plupart du temps il en parle au pluriel: ils ont fait des biges et des quadriges. Il résulte de tout ceci que le nombre des ouvrages de cette espèce était extrêmement considerable en Grèce, en Sicile, dans toutes les contrées peuplées par des colonies grecques, et gouvernées ensuite par les successeurs d’Alexandre. Après la conquête, ces pays furent dépouillés par les Romains à plusieurs reprises; après Auguste, Néron enleva encore beaucoup de statues à la Gràce. Il est donc infiniment vraisemblable que parmi ces trophées on aura transporté à Rome aussi des quadriges de bronze.
Je passe à l’examen d’un autre argument. On remarque de fortes traces de dorure sur les chevaux de Venise, et les Grecs, dit M. de Cicognara, ne doraient pas leurs statues de bronze.
Quand même on voudrait admettre le fait, cet argument n’en serait pas plus concluant. Les Romains, par leur goût habituel pour la magnificence, ont pu faire dorer ces chevaux, après les avoir transportés dans leur capitale, quoiqu’ils ne l’eussent pas été dans leur capitale, quoiqu’ils ne l’eussent pas été dans leur emplacement primitif en Grèce.
M. de Cicognara semble blâmer la dorure comme une faute de goût. La sculpture, il est vrai, considerée dans son essence, ne doit pas fasciner les yeux par la variété des couleurs et l’éclat des matières précieuses. Elle doit se borner à l’imitation des belles formes, et pour les faire ressortir davantage, elle doit se servir de matières d’une teinte unie, et dont les reflets, en éblouissant, n’empêchent pas de bien discerner les contours. Mais l’art, même en Grèce, ne fut pas toujours pratiqué conformément à la théorie. Nous savons maintenant, par les fragments découverts à Égine, que les Grecs ont d’abord commencé par peindre les vêtements, les armures, les yeux, et peut-être les lèvres de leurs statues, au moins dans cette ancienne école de l’art, désignée par le terme de style éginéen. Ensuite le grand Phidias se plut à composer des figures colossales, dont la chair était d’ivoire, la chevelure et la draperie d’or massif; dans les yeux l’artiste imita même la couleur de l’iris et de la prunelle par des pierres précieuses. Ce n’est que vers le temps de Praxitèle que la sculpture, dédaignant les ornements étrangers, osa se présenter dans la lice, nue et parée de sa seule beauté, pour lutter contre la nature. Mais il y eut toujours des exceptions à cette règle. L’assertion que les Grecs n’ont jamais doré leurs statues est si peu fondée, qu’on peut alléguer plusieurs exemples du contraire. Je viens de citer la Victoire de bronze doré sur le temple de Jupiter Olympien. Je suis porté à croire que la simple dorure des bronzes était tellement commune en Grèce, que les auteurs qui en parlent ne se donnent pas seulement la peine de les désigner autrement que comme des statues d’airain, parce qu’une pareille dorure ne rendait guère I’objet plus précieux. Il me semble que le terme ἐπίχρυσος, dont Pausanias se sert plusieurs fois, ne veut pas dire doré, comme nous l’entendons, mais couvert de plaques minces d’or battu2. Cela est évident par un passage de Pausanias, où il parle d’une statue de Minerve de bronze doré, que les Athéniens avaient offerte en don à l’Apollon de Delphes, placée sur un palmier également de bronze. Pausanias vit la surfave d’or endommagée en plusieurs endroits. On débitait à Delphes un récit miraculeux d’une nuée de corbeaux, qui étaient venus fondre sur cette statue, et l’avaient déchirée à coups de bec, comme pour annoncer un événement funeste. Mais Pausanias suppose que des voleurs auraient fait ce dégàt. Or une simple dorure amalgamée par un procédé chimique avec la surface du bronze, ne pouvait être un appât suffisant pour engager des voleurs à une entreprise aussi périlleuse, surtout à Delphes, où il y avait tant de choses plus précieuses à voler: c’étaient donc des plaques d’or qui tentèrent leur avarice et qu’ils s’efforcèrent d’arracher. D’après cela, je crois que la Victoire sur le temple de Jupiter à Olympie, et la statue de Phryné dans l’enceinte sacrée de Delphes, étaient également couvertes d’or, et non pas simplement dorées. Phryné, en offrant son portrait en don, voulut sans doute en même temps étaler sa beauté, les richesses acquises par ses charmes, et le talent de son amant; et Praxitèle dut en cette occasion complaire à sa maîtresse, soit par le choix de la matière (car cet artiste ne travaillait que rarement en bronze, et moins heureusement qu’en marbre), soit par une parure étrangère à son art.
Néron fut blâmé pour avoir fait couvrir d’or une statue d’Alexandre adolescent de la main de Lysippe. On trouva que le charme de l’art était détruit par la magnificence: on enleva l’or, et Pline vit les cicatrices et les égratignures que cette opération avait laissées dans le bronze. Il n’aurait pas pu s’exprimer ainsi, ce me semble, sur une simple dorure, qui n’altère en rien les contours. Mais, quoi qu’il en soit, il n’en est pas moins prouvé, par les exemples cités, que les Grecs doraient quelquefois les statues de bronze, et même dans les plus beaux temps de l’art, puisque de Phryné était de Praxitèle, et que la statue de Minerve sur le palmier existait lors de l’expédition des Athéniens en Sicile.
Je ne vois pas ce qu’on pourrait objecter sous le rapport du goût à la dorure des bronzes, si ce n’est l’éclat métallique; car du reste la teinte de l’or est belle et unie, et de plus elle a l’avantage d’être inaltérable. Or le cuivre encore neuf est pareillement luisant, et d’une couleur rougeâtre beaucoup moins agréable. Cette teinte douce et foncée, cette belle patine, qui plaît dans les bronzes antiques et dans les bronzes modernes déjà vieillis, l’airain ne la prend que peu à peu par le contact de l’air, et quelquefois il la prend inégalement. Pline dit qu’anciennement les statuaires grecs mêlaient souvent de l’argent et même de l’or avec le cuivre employé à fondre des statues. lls le faisaient probablement pour rendre le métal plus fusible en lui conservant sa ductilité, peut-être aussi pour le garantir du vert de gris, et pour obtenir une plus belle teinte. Après une telle profusion de matières précieuses dans la composition du métal, on se sera sans doute épargné la dorure. Mais on pouvait avoir un motif particulier de l’employer pour les quadriges, puisqu’ils étaient souvent destinés à être vus à distance 3. Je conviens qu’on ne saurait guère regarder fixement, sans être ébloui, un quadrige doré sur le faîte d’un édifice sous un soleil ardent en plein midi. Je l’ai mille fois éprouvé en observant les chevaux de Venise à Paris sur l’arc de triomphe des Tuileries, où ils étaient exposés aux reflets croisés d’un grand char et de deux Victoires dorées. Mais cet inconvénient est racheté par l’effet magique que produit la dorure aux heures du lever et du coucher du soleil.
M. de Cicognara tire une autre induction des imperfections de la fonte, qu’il a remarquées sur les corps de ces chevaux, pour les attribuer au règne de Néron. Selon Pline, l’art de jeter en bronze était totalement perdu à l’époque où il écrivait; ainsi cet art devait être sur son déclin dès la génération précédente. Observons cependant que l’art de jeter en bronze peut être facilement perdu faute de pratique, et facilement recouvré par l’exercice. Car l’habileté dans ce métier ne tient en rien au génie des beaux-arts, mais à une suite de procédés mécaniques qu’enseigne l’expérience. On a recommencé à jeter très-bien en bronze après le temps de Pline, comme le prouve la statue équestre de Marc-Aurèle. Je ne crois pas qu’on puisse fondre aucun ouvrage de bronze d’une grandeur considérable si parfaitement, qu’en sortant du moule n’ait pas besoin d’être retouché çà et là. On n’a qu’à voir ce que dit à ce sujet Benvenuto Cellini, qui était pourtant un artiste expérimenté. Les chevaux en question sont de cuivre presque pur, qui entre moins facilement en fusion que lorsqu’il est mêlé d’étain ou de zinc. Quelques creux restés dans le corps après le jet ne doivent donc pas surprendre. M. de Cicognara dit lui-même que le jet des têtes et des jambes est parfait; ainsi cet ouvrage peut être considéré comme excellent aussi sous le rapport de la fonte.
Enfin M. de Cicognara appuie sa thèse sur le caractère des chevaux de Venise, lequel, selon lui, ne ressemble pas au caractère des chevaux véitablement grecs: ils sont charnus et ont les formes arrondies, tandis que les derniers étaient secs et sveltes et avaient la croupe assez anguleuse, comme on le voit par les bas-reliefs du Parthénon. Mais ces bas-reliefs sont du temps de Phidias: on pourrait douter si leurs formes ne tenaient pas autant aux principes sévères de l’art à cette époque qu’à la nature des chevaux qu’on imitait. Par l’examen de ces mêmes médailles de Syracuse, que M. de Cicognara allègue en sa faveur, ce doute s’est transformé pour moi en certitude. A mesure que ces médailles portent les marques d’une plus haute antiquité, la maigreur des formes est plus exagérée; dans toutes celles qui n’ont pas encore l’oméga dans la légende Συρακοσιων, l’on peut compter sur des chevaux décharnés. J’ai vu une médaille de cette espèce, dont la tête de Proserpine tient encore de la roideur égyptienne: les deux chevaux du char avec leurs jambes longues et etfilées ressemblent absolument à des mules affamées. En revanche les médailles syracusaines, dont le type annonce la perfection de l’art, nous montrent aussi des chevaux pleins de feu et en même temps mieux nourris. La collection de la Galerie de Florence possède un superbe exemplaire d’un Brand médaillon de Syracuse, décrit par Eckhel (Doctrina numor. veter., P. I, V. 1, p. 242, in fin., et 243), d’un admirable type, dont le relief fort saillant permet d’apercevoir parfaitement l’embonpoint des chevaux du quadrige. L’épaisseur et le port du cou, le volume du corps, la croupe arrondie, tout enfin est dans le genre de ceux de Venise, excepté que la médaille nous montre les chevaux lancés au galop. On voit donc clairement que la maigreur ne doit pas être attribuée à la nature imitée, mais aus style de l’art qui, avant d’arriver à un dessin moelleux, caractérisait avec effort, et détaillait péniblement les ressorts du mouvement dans les corps organisés. En rapportant le médaillon que je viens de décrire aux derniers temps de l’indépendance de Syracuse, comme je pense qu’on doit le faire, il appartiendra toujours au siècle qui a suivi celui d’Alexandre-le-Grand: ainsi I’on ne saurait le récuser sous le rapport de l’originalité et de la pureté du style.
Les chevaux de la frise du Parthénon sont en effet secs, musculeux et d’une chair compacte: mais étant d’un relief très-peu saillant, nous ne pouvons pas juger de leur épaisseur comme s’ils étaient de ronde bosse. Xénophon, dans son livre sur l’équitation, veut qu’un bon cheval ait le poitrail large, les épaules épaisses, les hanches larges et charnues, et que les jambes ne soient pas trop rapprochées. Il est vrai que les préceptes de Xénophon tendent à former des chevaux de guerre, et non pas des chevaux de course. Mais aussi dans les chevaux grecs destinés à la course de chars, l’on ne doit pas se figurer la maigreur efflanquée, la taille élancée et étroite des chevaux de course anglais. Un attelage de quatre chevaux de front, et la forme du stade qui exigeait des tours fréquents, devaient nécessairement rallentir la course, de sorte qu’on pouvait y employer des chevaux bien nourris et de proportions un peu fortes, comme en Hollande on fait courir au trot les chevaux frisons. Les artistes, en faisant des quadriges en l’honneur des vainqueurs aux jeux olympiques, auront sans doute pris pour modèles les coursiers victorieux. Or on voyait concourir à Olympie et dans les autres jeux de la Grèce, des chevaux venus de la Sicile, de Cyrène en Afrique, des îles, enfin d’Épire et de Macédoine; par conséquent les artistes étaient appelés à imiter des chevaux de races bien différentes.
Pour les chevaux de Venise, je ne pense pas même qu’il faille les considérer comme des chevaux de course. Ce sont des étalons, et c’étaient d’ordinaire des juments qu’on dressait à la course de chars. Sophocle, dans sa fameuse description des jeux pythiques, parle toujours des coursiers au féminin; Pindare de même, le peu de fois qu’il indique le sexe des chevaux. Hérodote aussi cite deux attelages de quatre juments qui avaient remporté trois prix successifs aux jeux olympiques. Je n’oserais pourtant pas faire de cela une règle générale: les noms des chevaux du char de Cléosthène sont masculins. Ce qui est plus important à remarquer, c’est que les chevaux de Venise marchent au pas et d’une allure fort calme. On voit sur les vases, les médailles et les pierres gravées, une foule de quadriges dont les chevaux se dressent sur les pieds de derrière, comme pour s’élancer au galop. Les Grecs aimaient à faire caracoler les chevaux; on les dressait exprès à cela; ce n’est que dans cette attitude, dit Xénophon, qu’un cheval déploie toute sa beauté. En conséquence je présume que les chevaux de course étaient d’ordinaire figurés bondissant et partant au galop. Le bronze s’y prêtait d’autant plus facilement que le devant du corps n’avait pas besoin d’un support aussi lourd que dans le marbre.
D’après tout cela il paraît que les chevaux de Venise ne doivent pas être pris pour des chevaux de course, mais plutôt pour des chevaux de parade, tels qu’on les employait dans les entrées solennelles et les pompes sacrées. Sous ce point de vue on ne saurait assurément blâmer leurs proportions comme trop lourdes.
L’auteur de l’extrait inséré dans la Bibliothèque italienne traite d’ineptie la supposition de quelques antiquaires français qui ont pensé que les chevaux de Venise pourraient bien être de Lysippe. J’ignore par qui cette thèse a été soutenue, mais je suis fort éloigné d’y voir rien d’absurde. Ce serait une autre affaire, si l’on voulait attribuer cet ouvrage à Calamis: il n’est pas travaillé dans un goût assez austère pour cela.
Exactis Calamis se mihi jactat equis.
Le style de Lysippe, au contraire, était animé, facile, élégant; ce beau génie brillait par la vérité de son imitation. Pour affirmer positivement que ces chevaux ne peuvent pas être de la main de Lysippe, ou sortis de son école, il faudrait posséder quelque ouvrage avéré de ce maître, et être à même de le comparer avec celui dont il s’agit. Mais nous ne pouvons nous former une idée des œuvres de Lysippe que par des données générales. Celles-ci au moins ne sont pas contraires à la supposition contestée et les circonstances historiques lui sont extêmement favorables. Tout le monde sait que les Vénitiens ont trouvé ces chevaux à Constantinople dans l’hippodrome, lors de la prise de cette ville en 1204. Une ancienne tradition, car il n’existe point de témoignage positif, porte que Constantin les y avait fait transporter de Rome. Du temps de cet empereur on ne savait plus rien faire de bon, on avait perdu le tact des beaux-arts, mais l’admiration des siècles passés pouvait encore diriger le choix parmi les ouvrages existants. Pense-t-on qu’un empereur absolu, et qui n’était en rien gêné ni par les droits des villes, ni par le respect pour les propriétés sacrées des divinités païennes, n’aura pas pris ce qu’il y avait de meilleur en ce genre, pour embellir une des plus magnifiques places de sa nouvelle capitale? On sait que même la statue de Jupiter Olympien a été transportée à Constantinople. Un quadrige ordinaire, et qui n’eût pas été l’ouvrage d’un maître renommé, n’aurait pas valu la peine d’être apporté de si loin. Rome n’avait encore subi les ravages d’aucune invasion; les conquérants républicains et ensuite les empereurs avaient à l’envi enrichi cette ville aux dépens de la Grèce. Les incendies peuvent avoir consumé quelque chose; mais il paraît que c’est précisément après le grand incendie que Néron envoya son commissaire Craton en Grèce pour enlever de nouveau les plus beaux ouvrages de l’art. Pline se plaint que dans son temps la foule des chefs-d’œuvre accumulés à Rome nuisait à leur juste appréciation. Ceux de Lysippe étaient particulièrement exposés à être transportés en Italie, parce qu’il avait beaucoup travaillé pour Alexandre-le-Grand; or la Macédoine, ayant été conquise par la force des armes, fut traitée avec moins de ménagement que beaucoup de villes de la Grèce, subjuguées graduellement sous le prétexte de l’alliance et de la protection. Aussi Quintus Metellus, surnommé le Macédonien, apporta-t-il à Rome les vingt-cinq statues équestres de Lysippe, érigées à la mémoire des cavaliers qui avaient péri au passage du Granique, tandis que Gaius Cassius, en dépouillant l’île de Rhodes, n’osa pas enlever aux Rhodiens le char du Soleil du même maître. Mais il y avait certainement à Rome d’autres quadriges de Lysippe, l’artiste le plus fécond et, après Calamis, le plus célèbre dans ce genre. Si le char doré du Soleil, posé par Auguste sur le temple d’Apollon Palatin,
Auro Solis erat supra fastigia currus,
n’était pas de la main de Lysippe, il aura été l’ouvrage de quelque autre artiste du premier rang, ainsi que les bœufs de bronze autour de l’autel, qui étaient de Myron.
Dire que les chevaux de Venise ont été travaillés à Rome du temps de Néron, c’est au fond une assertion très-hasardée, parce qu’elle énonce, sans témoignage quelconque, un fait positif et particulier. Je pense que cette notion, répandue parmi les antiquaires, doit son origine uniquement à une médaille de cet empereur, dont le revers porte un quadrige sur un arc de triomphe. On voit d’abord combien cet argument est faible et précaire. Saus doute, la médaille rappelle un arc de triomphe-erigé avec son ornement habituel en l’honneur de Néron: mais s’ensuit-il que ce quadrige ait été jeté en bronze à Rome exprès pour cela, et que ce soit précisément le même que nous avons? Le commentateur des statues de Saint-Marc va jusqu’à citer comme un trait particulier de ressemblance les crinières coupées des chevaux. Mais cet usage, quoiqu’il ne remonte pas jusqu’au temps d’Homère; a été de bonne heure très-répandu chez les anciens: les chevaux de la frise du Parthénon ont également la crinière coupée et arrangée en crête, et cela se voit sans cesse dans les monuments antiques.
Quoi qu’il en soit, si l’opinion de M. de Cicognara est fondée, il n’en faudra pas moins attribuer les chevaux de Vernise à quelque artiste grec établi à Rome. Je ferai ici une observation générale sur l’histoire des arts. C’est à tort, ce me semble, qu’on y parle d’ouvrages romains en opposition avec ceux des Grecs. Les Romains, a quelques exceptions près, n’ont jamais exercé les beaux-arts, ils n’en avaient pas le talent, ainsi qu’ils le reconnaissent eux-mêmes:
Excudent alii spirantia mollius aera,
Credo equidem, vivos ducent de marmore voltus.
lls n’ont fait autre chose que dépouiller la Grèce d’abord. ensuite faire travailler pour eux des artistes grecs ou formés à une école grecque. Ces artistes ne pouvaient plus s’élever aussi haut que ceux de la Grèce encore indépendante, parce que la sublime époque du génie créateur était passée dans les arts comme dans la poésie; parce que l’émulation et I’amour de la patrie ne les animaient plus; parce qu’à Rome ils n’avaient pas, comme en Grèce, Ie peuple le plus sensible au beau pour spectateur et juge; parce qu’enfin ils vivaient dans une situation subalterne. Cependant ils avaient toujours encore les grands modèles sous leurs yeux. Plus on leur accordait de considération, et plus ils se rapprochaient de l’ancienue perfection, ainsi qu’on le voit sous Adrien, qui lui-même par ses mœurs et ses goûts appartenait presque à la Grèce. Il ne sœagit done pas de distinguer les œuvres également originales de deux nations différentes, comme par exemple celles des Égyptiens et des Grecs, mais de distinguer les diverses époques de l’art chez une même nation: celle de l’originalité et celle de l’imitation bonne ou mauvaise. On peut diviser l’histoire des arts chez les Grecs en quatre époques: la première s’étend depuis la naissance des arts jusque vers le siècle de Périclès; la seconde depuis Phidias jusqu’à la 120ème Olympiade. Ensuite il y eut un long intervalle, et les beaux-arts ne recommencèrent à fleurir en Grèce que vers la 155ème Olympiade; voilà la troisième époque, fort estimable encore, selon Pline, mais inférieure à la précédente. Vient enfin l’époque des empereurs romains qui se prolonge jusqu’à la décadence des arts. La troisième époque et la première partie de la quatrième doivent avoir été par rapport à la seconde à peu près ce qu’est l’école des Carraches, comparée à celles de Raphaël et de ses contemporains. Il sera toujours bien difficile de distinguer, par le style seulement, les ouvrages faits en Grèce après la 155ème Olympiade, de ceux faits à Rome sous les premiers empereurs, à moins que quelque circonstance étrangère à l’art ne vienne à notre secours, comme par exemple à l’égard des bustes qui représentent des personnages historiques.
ll serait vraiment surprenant que de tant de chefs-d’œuvre des grands artistes grecs de la seconde époque, entassés dans l’ancienne Rome, dans ses environs, et dans les maisons de campagne des seigneurs romains, rien, absolument rien ne fût parvenu jusqu’à nos jours. Jadis on était trop porté à reconnaître quelque illustre original dans chaque morceau antique d’une certaine valeur; aujourd’hui, ce me semble, on donne dans l’excès contraire. Autrefois l’on avait admis tout bonnement que les colosses de Monte-Cavallo étaient l’ouvrage, l’un de Phidias et l’autre de Praxitèle, c’est-à-dire de deux artistes qui n’étaient pas contemporains, et formaient contraste autant par leur goût et leur génie que par le genre qu’ils cultivaient de préférence. D’autre part le savant auteur du Musée Pio-Clémentin, l’abbe Visconti, conteste à ces figures heroiques l’honneur d’avoir été sculptées en Grèce; il pense qu’on n’aurait pas transporté des statues aussi colossales. Quel argument! comme si les Romains n’avaient pas embarqu des óbélisques! D’ailleurs ces oolosses sont de marbre de Thasos, et les blocs dont ils ont été formés étaient nécessairement beaucoup plus lourds que les statues déjà terminées. Le style en est assurément assez grandiose pour ne pas déshonorer le siècle d’Alexandre-le-Grand.
L’on a déjà rendu accessibles aux connaisseurs plusieurs productions originales, trouvées en Grèce, qui appartiennent aux deux premières époques de l’art, et auxquelles on peut assigner une date assez précise: les sculptures d’Athènes apportées à Londres par Lord Elgin, celles d’Égine et de Phigalie, découvertes nouvellement par une société de voyageurs. A mesure que ces découvertes se multiplieront, I’histoire de l’art pourra marcher avec plus d’assurance.
On sortirait de la circonspection que nous imposent nos connaissances imparfaites, en voulant attribuer le quadrige vénitien précisément à tel ou tel maître; cependant je me flatte d’avoir établi avec quelque probabilité que cette noble production, inappréciable parce qu’elle est l’unique de son espèce qui nous reste, pourrait bien provenir de quelque artiste distingué, contemporain d’Alexandre-le-Grand ou de ses premiers successeurs.
En soumettant ces réflexions à votre jugement, j’ai l’honneur d’être avec la considération la plus distinguée,
Messieurs,
Votre très-humble et très-obéissant
serviteur
A. W. de Schlegel
Florence, en Mai 1816.
1 Des recherches plus approfondies m’ont convaincu que toute cette histoire est apocryphe, et qu’elle doit son origine à la vanité de quelque auteur grec. (Voir les Annales littéraires de Heidelberg, 1816, No 48.) Tarquin, qui portait le nom de sa ville natale, fut élu roi de Rome, l’an 617 avant J. C., étant déjà d’un âge mûr. Cela fait remonter l’arrivée de Damaratus en Étrurie vers le milieu du septième siècle avant notre ère. Or à cette époque les beaux-arts étaient à peine ébauchés en Grèce; et l’on peut raisonnablement douter la-quelle des deux nations, étrusque ou grecque, était le plus en mesure de devenir l’institutrice de l’autre. Selon Pline, Damaratus aurait amené avec lui deux artistes habiles dans la plastique, qu’il nomme Euchir et Eugrammus, c’est-à-dire Bonnemain et Bondessein. On voit d’abord que ce sont des noms inventés à plaisir. Je ne nie point que les Étrusques n’aient adopté plusieurs usages grecs. Entre autres I’introduction de la mythologie héorïque des Grecs, prouvée aussi bien par des ouvrages de l’art que par des témoignages positifs, est un fait des plus curieux. Mais dans les beaux-arts les Étrusques ont maintenu longtemps un caractère original. Horace cite, parmi les objets de luxe très-recherchés par les riches, les figurines étrusques (Tyrrhena sigilla), quoique Rome abondât alors en chefs-d’œuvre grecs. Si ces figurines ressemblaient au Mars du musée de Florence (Micali, T. XXI), je ne m’en étonne point.
2 C’est incontestablement dans ce sens qu’Hérodote emploie les termes ἐπίχρυσος et ἐπάργυρος, lib. IX, c. 80
3 Je ne serais pas étonné que l’épithète χρυσάρματος, que Pindare donne si souvent aux divinités, eût été suggérée à l’imaginaion du poëte par la vue de ces chars réellement dorés.