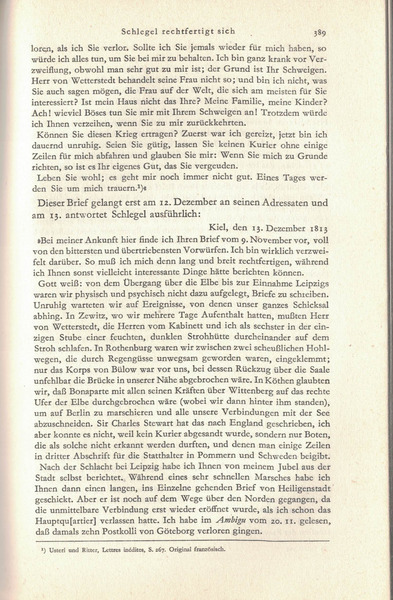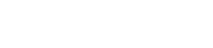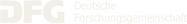En arrivant ici hier, j’ai trouvé votre lettre du 9 9bre, remplie des reproches les plus amers et les plus exagérés. J’en suis vraiment désolé. Me voilà réduit à faire une longue et ennuyeuse justification, tandis que j’aurais pu peut-être vous mander des choses intéressantes.
Dieu sait que depuis le passage de l’Elbe jusqu’à la prise de Leipzig notre situation n’est pas telle qu’on fût physiquement et moralement bien disposé pour écrire des lettres. Quelle attente inquiète d’événemens dont tout notre sort dépendait! A Zewitz nous avons été plusieurs jours, M. de Wetterstedt, les messieurs du Cabinet et moi sixième dans l’unique chambre d’une chaumière humide et sombre, couchés pêle-mêle sur la paille. A Rothenburg nous étions entre deux affreux défilés, devenus impraticables par les pluies, le Corps de Bülow seul en avant de nous, dont la retraite, s’il avait été rejeté sur la Saale, aurait infaiblement rompu notre pont. A Cöthen nous avons cru que Bonaparte avait percé avec toutes ses forces par Wettenberg sur la rive droite de l’Elbe, nous laissant en arrière, marchant sur Berlin et coupant toutes nos communications avec la mer. Sir Charles Stewart a écrit cela en Angleterre, moi je n’étais pas à même de le faire, parce qu’on n’envoya point de courrier, mais des messages qui ne devaient pas être reconnus comme tels et auxquels on donne quelques lignes en triplicatats (sic) pour avertir les gouverneurs en Poméranie et en Suède.
Après la bataille de Leipzig je vous ai écrit mes jubilations de la ville même. Pendant une marche très rapide je vous ai fait ensuite une lettre longue et détaillée, une espèce de livre qui a été expédiée de Heiligenstadt. Mais cela a passé encore par la voie du Nord, la communication directe n’a été rouverte que depuis que j’ai été absent du Quartier G[énéral]. J’ai lu dans l’Ambigu du 20 9re qu’il manquait alors dix malles de Gottembourg.
Lorsque le Pr[ince] R[oyal] est parti de Goettingue, il m’y a laissé pour soigner plusieurs imprimés et pour faire un grand travail sur les dépêches interceptées. Cela m’a retenu plus longtemps que je ne pensais – j’y suis resté plus de trois semaines; pendant ce temps-là je ne pouvais pas profiter du départ des courriers que j’ignorais. Je ne me suis arrêté que quelques jours à Hanovre. On pourrait bien aussi accorder quelque indulgence à l’heureuse distraction d’avoir revu ma patrie et ma famille dans des circonstances aussi extraordinaires. Il m’a fallu faire 80 lieues à petites journées, avec les mêmes chevaux, pour rejoindre le Quartier G[énéral] que je n’ai rattrapé qu’à Segeberg, à 8 milles d’ici. Voici le premier courrier dont malheureusement je ne profite pas, puisque tout ceci serait superflu pour votre lettre.
Quand on est séparé par des mers et peut-être par des armées il ne faudrait pas gronder ses amis pour un simple retard de lettres, lequel peut être causé par mille accidents. Il ne faudrait en général pas se déchaîner sans avoir une preuve manifeste de perfidie entre les mains; encore faudrait-il y prendre garde parce qu’il s’écoule des mois avant qu’on puisse réparer le mal qu’on a fait. Comment saviez-vous si je n’étais pas malade ou mourant, et si l’on ne m’administrait pas votre lettre comme un viatique pour l’autre monde? Je pouvais être mort, de bien plus braves gens que moi sont morts dans cette campagne, sans qu’on se soit pressé de le mander en Angleterre.
Vous avez souvent loué les nombreuses lettres que je vous ai écrites pendant cet été. Est-ce que chez vous les bonnes œuvres ne comptent pas un peu pour excuser des péchés? Vous jouissez de votre loisir tout entier; moi, quand même je ne fais pas grand chose, je ne suis pas maître de mon temps. Souvent, pour avoir une audience de 5 minutes, il faut attendre plusieurs heures. La journée se passe ainsi. Le soir je ne suis pas en état d’écrire des lettres, outre que cela me fatigue la vue. Il faudrait un peu vous mettre à ma place, et tenir compte de cette vie ambulante du Q[uartier] G[énéral], remplie de mille distractions, exposée à mille incommodités, entraînant mille pertes de temps.
J’ai été aussi plusieurs fois très longtemps sans lettre de votre part – je m’en suis toujours pris aux vents et à la mer. Hier Löwenhjelm me dit qu’il avait vu votre ouvrage sur l’Allemagne à Franckfort, que S. Ch. Stewart l’avait déjà. Je pense que je mériterais bien le premier exemplaire sur le Continent – je suis convaincu que vous me l’avez destiné et je n’imaginerais pas de vous faire des reproches d’un hasard contraire.
Chère amie, je pense que l’indulgence est un des caractères les plus essentiels de l’amitié – elle est faite pour répandre de paisibles douceurs sur la vie: elle perdrait tout son privilège si elle était orageuse. Vous savez que j’ai de l’indolence et de la lenteur dans le caractère; moi, je le sais fort bien, car cela m’a valu de faire bien moins de chemin que je n’en aurais pu faire avec mes moyens. Je n’ai pas le talent d’écrire en un instant une quantité de lettres – il me faut du repos pour cela, c’est une résolution, c’est un travail. Un des premiers jours que je vous ai vue à Berlin, je disais, en vous voyant recevoir une foule de billets et y répondre, que cela me tuerait. Me voilà arrivé à l’âge où l’on se corrige difficilement de ses défauts, quelque bonne volonté qu’on en ait. Il faut me prendre tel que je suis, autrement on me désorganiserait entièrement. Pendant tout l’été je n’ai pas écrit une seule fois à Frédéric – il s’en plaint aussi, avec raison, mais plus doucement.
On doit expédier un courrier aujourd’hui; pour ne point risquer de retard je termine ici ma lettre, mais j’en commencerai incessamment une autre. Quelle déplorable manière de remplir les pages! Enfin ce n’est pas ma faute. Je vous envoye une lettre de M. B[enjamin] C[onstant] qui se plaint de n’avoir point eu de lettre de vous depuis le mois de juin. Baudissin est ici à ma grande joye, il est très reconnaissant de votre lettre, il vous écrira lui-même. Mille amitiés.