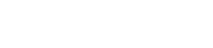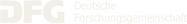Chère amie, j’ai été bien malade d’une fluxion de poitrine qui menaçait de tourner tout à fait en inflammation des poumons; en même temps j’étais dans un tel épuisement qu’on n’osait pas me tirer du sang. Heureusement j’ai pu avoir ici un excellent médecin et être soigné à merveille chez mon frère. J’en relève enfin, depuis quelque temps j’ai quitté mon lit, mais les forces ne me reviennent que peu à peu, la toux ne me quitte pas, et le médecin ne me permet pas encore de m'exposer à l’air par ce froid rigoureux.
Je suis arrivé ici le dernier jour de janvier; j’avais devancé le Pr[ince] R[oyal] en partant de Lubeck et comptant gagner ici quelques jours pour la société et le travail, j’allai en courrier jour et nuit; le temps affreux qu’il fesait pendant ce voyage fit éclater le mal dont je portais déjà le germe en moi. Aussitôt arrivé je tombai malade, et après un vain effort de sortir et de faire semblant d’être en bonne santé, je fus bientôt entièrement accablé.
J’ai prié M. Constant de vous parler légèrement de mon indisposition, afin que vous ne fussiez ni inquiète, ni fâchée de mon silence.
Voilà un mois perdu et c’est encore un grand travail pour moi que d’écrire. J’espère que vous aurez reçu tout ce que je vous ai envoyé de Kiel. J’ai envoyé un gros paquet et je pense plusieurs lettres par la voye du cabinet, j’en ai donné une au marquis de L. M. et deux au Cte de Bouillé.
J’ai reçu ici, les premiers jours de février, votre lettre du 17 janvier par Lowenhjelm – il aurait bien pu venir me voir pour me donner verbalement de vos nouvelles, mais il aura été trop distrait. Je m’en vais répondre tout-à-l’heure à cette lettre. Je n’en ai plus reçu depuis, et cela est tout naturel. Ne croyant pas que je serais retenu si longtemps loin du Quartier G[énéral] et craignant de manquer tout à fait ce qui me serait envoyé ici, j’ai prié Schulzenheim de garder là-bas tout ce qui arriverait pour moi. M. Constant m’a parlé d’une lettre postérieure, qu’il avait reçue de votre part, mais il a toujours oublié de me la montrer.
Chère amie, votre proposition de vous accompagner dans un voyage d’Ecosse et de l’Irlande est très attrayante en elle-même, mais je ne sais pour ce printemps aucunement l’arranger avec la chronologie des événemens probables ou possibles. Si à cette époque le Moloch est renversé ou prêt à l’être, vous serez trop intéressée à savoir comment les choses tourneront en France pour vous fourvoyer dans des pays solitaires, et vous éloigner du centre des nouvelles. S’il reprend ses forces, l’Europe périclite de nouveau, et alors notre inquiétude nous rendrait bien peu disposés é jouir des beautés de la nature. Ce voyage serait une idylle au milieu des derniers chants de l’Iliade. Ensuite vous paraissez supposer qu’il ne dépend que de moi de dire: oui. Mais je suis au service du P[rince] R[oyal], et il me faut sa permission. Après ce congé involontaire que ma maladie m’a forcé de prendre, comment pourrai-je demander un si long congé dans le moment le plus décisif? Ce serait le quitter entièrement lui et toute la partie.
En pensant très sérieusement à la mort, je l’ai envisagée avec assez de calme; il me semble que la vie ne me promet guère plus de jouissances bien vives. Parmi les biens qu’il aurait fallu quitter, j’ai cependant vivement regretté votre amitié. Les intérêts de cette amitié se combinent toujours dans mon esprit avec celui que je prends aux événemens. Ma chimère favorite, c’est de vivre avec vous à Paris sous les auspices de quelqu’un que nous aimons et admirons tous les deux – en passant toutefois une partie de l’été à Coppet. Nous tâcherons de faire quelque bel ouvrage; du reste on jouirait bien du repos après tant de tribulations.
Jai vu le Pr[ince] R[oyal] en dernier lieu à Lubeck; il est toujours extrêmement bien pour moi. Je vous dois aussi beaucoup à l’égard de cette relation aussi honorable qu’agréable.
Le Quartier G[énéra]l devait être jusqu’au 26 fév[rier] à Cologne. Le 22, j’y ai expédié une estafette avec un énorme paquet des pièces réimprimées, que j’ai soigné tant que j’ai pu malgré ma maladie.
Mais je ne puis pas m’attendre à recevoir des nouvelles de là parce qu’on ne me suppose plus à Hanovre. Mes dépêches interceptées viennent de paraître ici. Je suis inquiet sur le sort de la copie que j’ai envoyée à Auguste par la voye du Cabinet. Elle n’était pas encore arrivée à Londres le 17 janvier; cependant elle est partie de Kiel au commencement de l’année. Je suis aussi curieux de savoir ce que vous jugez de ma préface. Elle a en général beaucoup de succès et mon protecteur en a été vraiment enchanté.
Figurez-vous que je n’ai pas encore votre ouvrage, tandis que les contrefactions et les traductions qu’on en fait en Allemagne sont fort avancées. Si j’étais porté aux gronderies et aux plaintes, il y aurait de quoi. Au nom du ciel qu’avez-vous fait des exemplaires qui nous étaient destinés? Vous les avez envoyés en Suède, et vous ne pouviez alors faire autrement; mais vous saviez qu’en Suède il n’y a point de diligences, ni rouliers et qu’un paquet peut moisir tout à son aise dans un port de mer, si l’on ne prend pas de voyes extraordinaires. Il fallait donc charger un banquier de Gothembourg d’envoyer ce paquet par une estafette à Gstad – d’après les prix de Suède cela n’aurait coûté qu’une bagatelle. Plus tard la mer a été encombrée de glaces, et le passage à Stralsund a été entièrement interrompu.
Votre préface est charmante et pleine de finesse. Cependant il me semble que vous rendez un peu faiblement justice aux Allemands. Que de traits il y aura à raconter de cette guerre! A présent que nous avons acquis les deux qualités qui nous manquaient, le sentiment de l’unité nationale et la faculté de l’action, nous allons devenir grands et faire des choses étonnantes. Vous voyez que la question sur la frontière du Rhin est décidée par le fait. Ce beau fleuve va relever ses cornes altières, ayant secoué le joug des forteresses françaises et ne voyant plus, depuis le mont Albula jusqu’à l’Océan sur ses deux rives, que des peuples unis par une confédération libre comme ils le sont par leur sang et leur langue.
Am Rhein! am Rhein! da wachsen unsre Reben!
Il me tarde bien d’y arriver.
Ce 5 mars. Je n’ai pas encore trouvé l’occasion pour faire partir cette lettre. Nos communications avec l’Angleterre sont bien incertaines – l’embouchure de l’Elbe et du Weser est encombrée de glaces. Je ne me fie pas encore au cours de la poste ordinaire par la Hollande. Enfin on m’a promis de mettre ceci dans le paquet du gouvernement.
Je ne fais pas de grands progrès dans ma convalescence. Je suis toujours au quinquina et à l’eau de Seltz, et je ne puis reprendre le sentiment de mes forces. Cependant j’espère être en état de faire le voyage vers la mi-mars. Il me faudra à présent chercher mon Prince au fond du Brabant ou peut-être sur les frontières de l’ancienne France.
Dans les premiers jours de ma maladie M. B[enjamin] C[onstant] est souvent venu me voir, et quoique je ne puisse dire six mots sans grand effort et sans me faire du mal, nous avons beaucoup parlé de vous et nous avons eu des entretiens très animés sur la cause et sur le rôle que Fortinbras doit y jouer. Je me flatte que dès mon premier passage ici j’ai beaucoup contribué à décider M. B[enjamin] C[onstant] à se prononcer. Il s’est nommé avec son titre républicain comme auteur de L’Esprit de conquête etc... et quoique ce livre soit écrit avec beaucoup de profondeur et d’éloquence, cela est plus essentiel que le livre lui-même – c’est un acte public et le premier de son espèce. Le Pr[ince], dans l’incertitude où en étaient les affaires, ne voulut pas qu’il fit une démarche aussi ostensible que celle de l’accompagner d’ici à Cologne. M. B[enjamin] C[onstant] devint donc de Berckebourg; mais peu de jours après il partit pour Goettingue sous un prétexte assez léger. Je crois que c’était pour échapper aux adieux de famille et aux objections qu’on lui opposerait. J’avais dit en partant qu’il reviendrait à coup sûr, mais il parait qu'il s’est mis en marche de là directement vers la scène d’action, au commencement de ce mois. Il y a quelque temps que sa femme vint chez moi, fort agitée parce qu’elle soupçonnait ce projet; elle m’engagea à lui écrire – moi aussi j’avais eu l’espérance que nous irions ensemble. Elle s’est un peu tranquillisée depuis, mais elle parle toujours d’aller le rejoindre; je lui représente de mon côté l’impossibilité pour une femme de vivre au Quartier Général.
Signeul est aussi venu me voir pendant le séjour de notre Prince ici. Il comptait partir tout de suite pour le Quartier Impérial; mais faute de loisirs pour recevoir des instructions définitives, il a été jusqu’à Cologne. Signeul est celui qui pousse le plus vivement aux démarches décisives – c’est pourquoi j’aimerais mieux le voir à notre Quartier G[énéral] qu’en mission. Enfin M. B[enjamin] C[onstant] peut le remplacer, et moi j’espère y arriver bientôt, avec quelques nouvelles brochures de ma façon dans ma poche. Nous sommes tous les trois parfaitement d’accord dans nos vues et dans nos souhaits.
J’ai écrit plusieurs fois à Auguste; je lui ai envoyé par le Cte de Bouillé une lettre de change de quatre cents livres sterling, payable à son ordre par Mrs George Frazer. J’espère que cette lettre de change sera heureusement arrivée et qu’il aura pu tirer cet argent. Je pense aussi que le manuscrit des Dépêches interceptées, envoyé dès le commencement de janvier à Londres, m’aura valu quelque chose.
J’ai détaillé à Auguste les raisons pourquoi une publication plus tardive en Allemagne ne peut pas nuire au libraire anglais. Je puis donc supposer de toutes les façons que vous ou Auguste, avez de l’argent à moi en dépôt. Ma maladie m’a causé beaucoup de dépenses; d’ailleurs je dois faire un long voyage en poste, ayant envoyé mes chevaux d’avance, parce qu’il était impossible de suivre à petites journées et que j’ai besoin de les trouver là-bas en bon état. Je tirerai donc cinquante livres sterling sur Auguste chez un négociant d’ici, j’accompagnerai ma traite exprès d’une lettre d’avis et je vous prie instamment de l’honorer en tout cas, quand même par un hasard fort peu probable vous n’auriez point d’argent à moi entre les mains.
J’ai la copie de la lettre de change de 400 £ sterling; si l’original était perdu je l’enverrais aussitôt, mais je l’endosserais avec votre nom pour le cas qu’Auguste fût déjà parti.
J’ai prié Aug[uste] de vous rembourser les 100 louis que j’ai pris sur votre lettre de crédit. Je vous dois encore le compte des affaires d’Albert – il me manque toujours 30 louis payables à Stralsund, du moins je n’ai point l’avis du marchand.
Ce 8 mars.
Chère amie, j’aurais bien des choses encore à vous dire, mais comme elles ne sont pas pour tout le monde, j’aime mieux les réserver pour une autre occasion, ne sachant pas à quels hasards cette lettre peut être exposée. Je réserve entre autres tout ce que j’aurais à vous dire sur le Cte W. B.; c’est certainement un jeune homme d’un caractère bien pur et bien noble.
Le Duc de Cambridge m’a fort bien accueilli – il m’a parlé de vous avec beaucoup d’intérêt. Je compte pouvoir partir en quatre ou cinq jours. Tout est encore rempli de neige.
Les affaires en France traînent un peu en longueur. On a fait quelques pas rétrogrades, mais sans revers essentiel. Il est bon qu’on voye que le problème n’est pas si facile à résoudre et qu’il faut un Deus ex machina pour cela.
Je suis si coupable envers Albertine par mon silence que je ne sais plus comment m’excuser. Pour lui écrire dignement il faut que ce soye la plus belle lettre que j’aye faite de ma vie, et je la porte depuis longtemps dans ma tête.
Je ne saurais vous exprimer mon impatience d’avoir de vos nouvelles. Je compte bien en trouver au Quartier G[énéral].
Adieu chère amie, quand aurons-nous le plaisir de causer ensemble? Il faut penser à une longue réunion – les choses durables seules valent quelque chose.
Ne quittez pas l’Angleterre d’une manière précipitée – il faut que le chaos du Continent soit débrouillé, avant que vous puissiez y vivre avec agrément. Mille amitiés.
Il pleut chez nous des brochures politiques; entr’autres il y en a de violentes contre la frontière du Rhin; sur les ponts on vend des chansons et autres burlesques pour le peuple. On chante des romances assez drôles sur les revers de Bonaparte avec des orgues de barbarie et cela ne manque pas d’attirer un public dans les rues.
Il parait autant de caricatures qu’à Londres – ce sont nos coups d’essai dans ce genre – quelques-unes, je pense, auraient des succès en Angleterre. Je vous en enverrai un paquet. D’un autre côté il s’élève des voix assez fortes contre nos menus tyrans et les iniquités de la Confédération du Rhin.