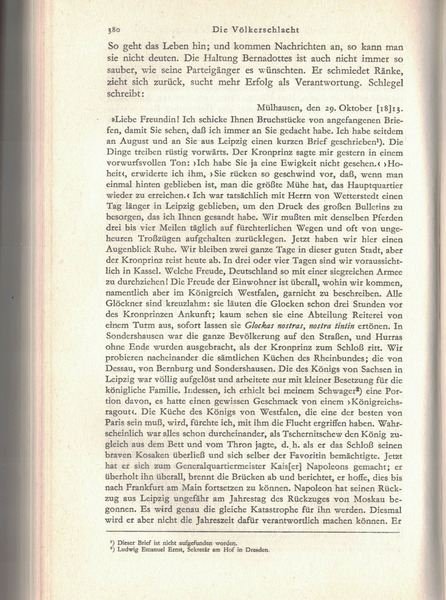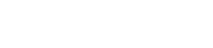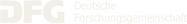Chère amie. je vous envoye des fragments de lettres commencées, afin que vous voyez que j’ai toujours pensé à vous. J’ai écrit depuis à Auguste et de Leipzig une courte lettre à vous. Les choses vont grand train. Hier le Prince Royal me dit avec un ton de reproche: il y a une éternité que je ne vous ai pas vu. – Monseigneur, répondis-je, vous allez si vite en avant que, lorsqu’on est resté une fois en arrière, on a toute la peine du monde à rattraper le Quartier Général. En effet, j’étais resté un jour plus longtemps avec M. de Wetterstedt à Leipzig, pour soigner l’impression du grand bulletin que je vous ai envoyé; il nous a fallu faire avec les mêmes chevaux 3 à 4 milles par jour, par des chemins affreux et souvent arrêtés par d’immenses trains de bagages. Voici un moment de repos, nous passons dans cette bonne ville deux jours entiers, mais le Prince Royal part aujourd’hui. En trois ou quatre jours nous serons à Cassel je pense. Quel plaisir de toiser ainsi l’Allemagne avec une armée triomphante. La joye des habitants, partout où nous arrivons, mais surtout dans le royaume de Westphalie, est indicible. Tous les sacristains sont éreintés: ils sonnent les cloches trois heures avant que le Prince Royal arrive, il leur suffit de découvrir du haut d’une tour un peloton de cavalerie pour faire d’abord bourdonner glockas nostras, nostra tintin. A Sondershausen toute la population était dans les rues et c’étaient des hourras sans fin, lorsque le Prince Royal monta à cheval au château. Nous tâtons successivement de toutes les cuisines de la Confédération Rhénane; nous avons eu celles de Dessau, de Bernbourg et de Sondershausen. Celle du roi de Saxe à Leipzig était plongée dans la consternation et ne travaillait qu’en petit comité pour la famille royale. Cependant, j’en ai pris chez mon beau-frère un morceau qui avait un certain goût d’un sauté de royaume. Je crains que la cuisine du roi de Westphalie laquelle doit être des meilleures de Paris, aura pris la fuite avec lui. Probablement, tout cela a déjà été en désarroi, depuis que Czernicheff a chassé le roi en même temps de son lit et de son trône, c’est-à-dire qu’il a livré le château à ses braves cosaques et qu’il s’est emparé lui-même de la favorite. A présent, il s’est constitué le quartier-maître général de l’Emp[ereur] Napoléon, il le devance partout en brûlant les ponts et il mande qu’il compte continuer ainsi jusqu’à Francfort sur le Mein. Napoléon a commencé sa retraite de Leipzig à peu près à l’anniversaire de celle de Moscou, elle sera tout aussi désastreuse, et cette fois-ci on ne pourra pas rejeter la faute sur la saison. Il ne peut pas quitter son armée parce que ses derrières sont infestés, il arrivera en France dans un pauvre état.
A Halle aussi la joye de la délivrance était bien grande. C’était touchant de voir arriver les soldats prussiens légèrement blessés qui pouvaient marcher, de petits garçons accouraient pour porter leurs fusils et les soutenir. Le quartier G[énéral] n’y a pas été, mais j’y suis resté avec M. de Wetterstedt depuis le 16 jusqu’au 18 octobre. Dans la soirée de ce dernier jour, lorsque la victoire était déjà décidée, de tous côtés, cette bonne ville eut une fausse alarme qui me coûta une nuit blanche. Ils ont une grande peur du retour des Français parce que Bonap[arte] leur a voué une haine particulière. Lors de sa tournée à Magdebourg pendant l’armistice, il fit une harangue aux magistrats et aux professeurs qui commença par ces mots: „Vous êtes tous des coquins, je devrais vous faire pendre tous.“ Ensuite, un tas d’injures vulgaires qu’on ne peut pas répéter. A côté de ce tyran, Caligula était de bon ton et Caracalla bien élevé; je ne parle pas de Néron: Néron était la fleur de l’élégance dans le genre tyrannique. Il ne faut pas les nommer le même jour.
Chère amie, il ne faut pas me blâmer d’aimer cette bonne et loyale Allemagne. D’abord, vous voyez comme elle se montre, ensuite j’y suis bien vu en mon particulier. A Halle, je m’en vais au bureau des quartiers demander mon billet: „Monsieur“, me dit-on, „vous n’avez pas besoin de billets, le professeur un tel a demandé exprès à vous loger.“ J’y fus et c’était une réception! Et à tous moments: „L’honneur et le bonheur de loger un tel homme“; et il fallait se garder de manifester le désir d’une chose quelconque, parce qu’ils se mettaient d’abord en quatre pour vous le procurer. Ici je suis de la même manière chez le recteur de l’Ecole.
Je n’ai été que peu de temps à Leipzig et j’étais bien aise de quitter ce lieu de désolation. Cette ville si riche et si populeuse, et dont les environs étaient si bien cultivés et si ornés, présentait en ce moment une foule d’objets. Le 19, à dix heures, Napoléon a quitté la ville, à midi les nôtres y sont entrés. Le 20, à la même heure, j’arrivai à cheval de Landsberg. Quoique je ne vinsse pas du côté des actions principales, les champs étaient jonchés de morts et de mourants. Quelques blessés s’étaient traînés dans les fossés le long du grand chemin; on entendait les râlements de leurs voix expirantes. Au milieu de cela des groupes de Cosaques errant dans la campagne pour trouver encore quelques dépouilles. Dans la ville même, derrière la porte du faubourg, il restait des cadavres. La charmante promenade entre la ville et les faubourgs était encombrée, encore deux jours après, de chevaux morts, de débris de vêtements, de tshacos (sic), de fusils brisés. Ensuite, figurez-vous 23 jusqu’à 30.000 (qui se donne la peine de les compter?) blessés et malades abandonnés par l’ennemi dans les hôpitaux. S’ils ne meurent pas de maladie, ils doivent périr de misère – les pays est dévoré, comment les nourrir? – Ceux qui pouvaient marcher se traînaient dans les rues, appuyés sur des béquilles. J’en ai vu chercher de la nourriture dans les tas de boue. Vis-à-vis de M. Wetterstedt était un hôpital; un homme est venu expirer à la porte. Il est resté étendu mort dans la rue plusieurs heures à demi nu. Le soir, tout cela rentrait dans ces sombres réduits, où ils sont entassés et l’on pouvait sortir sans en rencontrer, mais on n’était pas sûr de ne pas entendre percer des gémissements au travers de quelque mur épais. La pitié se blase à l’aspect de tant de maux, c’est la mer à boire. A côté de cela le mouvement animé et joyeux des vainqueurs. Leipzig semble renfermer le monde entier. En même temps les deux véritables empereurs y ont été, le Roi de Prusse et son fils aîné; le Prince Royal de Suède, le Roi de Saxe captif – ensuite tant de Ministres d’Etat, de généraux, des troupes de toutes les nations, partout des officiers galopant par les rues, la musique militaire, les fanfares. Löwenhjelm dit que Leipzig était Wilna en petit, et assurément la retraite, de là, a été un second passage de la Bérésina. J’ai été chez M. de Metternich et le Grand Chancelier d’Hardenberg, qui m’ont très gracieusement accueilli. J’ai aussi revu Humboldt et nous avons d’abord parlé de vous. Charles Löwenhjelm et M. Brandel m’ont aussi chargé de beaucoup de choses, je n’ai pas pu trouver Stein, quoiqu’il y fût.
Heiligenstadt, ce 31 oct.
Dites à M. de La Maisonfort que son fils et Löchner se sont fort distingués à la prise de Leipzig; ils se sont emparés de la porte de Grimma à la tête de quelques troupes prussiennes et sont entrés dans le faubourg sous une grêle de balles. C’est là que le brave major Döbeln fut tué, en dirigeant le canon dans la rue. J’aurais souhaité que leur nom fût mis dans le bulletin, mais je n’ai pas pu l’obtenir. Je trouvai dans le rapport du G[énéra]l russe le nom de Crassowski et force me fut de le mettre, quoique je susse que c’étaient eux qui avaient fait la chose. Cette omission cependant sera réparée; ils auront l’ordre de l’Epée et sont recommandés à l’Emp[ereur] de Russie par une lettre du Pr[incel R[oyal] à leur général.
Le P[rince] R[oyal] et Neipperg se sont revus d’une manière vraiment romanesque. Le premier ne savait pas encore que le corps de Bubna avait joint son aile gauche, lorsque Neipperg y arriva au grand galop, saluer le Prince au milieu de ce glorieux champ de bataille. Le P[rince] le reconnut de loin, vous concevez leur joye réciproque. Je n’ai pas vu Neipperg, il a marché en avant avec son corps.
Il y a quelques jours que j’ai reçu votre lettre du 25 avec la copie de la lettre de Moreau et j’ai fait vos commissions au Pr[ince]. Il les a très bien reçues; seulement les exhortations de ne point s’exposer ne lui font aucune impression. Vous savez que Suchtelen a eu un cheval de tué, un domestique d’un officier prussien a été blessé à dix pas de son maître.
Ce 1 nov[embre].
Je pensais vous raconter encore une infinité de choses, mais il faut finir. Nous sommes au moment de partir pour Göttingue, et la poste suédoise sera encore expédiée d’ici. Parlons affaires. Je n’ai pas encore payé le créancier d’Albert d’Hambourg, ni donné ordre qu’on le payât; je le renverrai à votre décision en lui disant de s’adresser à Arfwedson. Etant à Leipzig et ne sachant pas quand l’occasion se retrouverait, j’ai fait usage de ma lettre de crédit et je l’ai épuisée, il en restait environ 50 louis. Je suis bien aise de trouver votre approbation dans la lettre du 25 sept[embre]. Mes raisons étaient que: 1° je nai pas encore pu faire rentrer 30 frédérics, dus par un officier suédois pour des effets d’Albert et que je ne voulais pas faire attendre deux créanciers de la maison du Prince [nom illisible] et le dentiste Dubost, dont les créances faisaient ensemble 21 frédérics; 2° j’ai enfin acheté un cheval de selle, c’était de toute nécessité et si j’avais pris cette résolution deux mois plus tôt, j’aurais bien mieux vu et j’aurais fait la campagne avec infiniment plus de plaisir. Tout le monde s’est mis à cheval, M. Thornton depuis longtemps, M. Wirsin, M. de Wetterstedt. Du reste, je n’accepte pas votre offre généreuse d’un nouveau crédit; je suis très en fonds comme il faut l’être dans la guerre, et le P[rince] m’a dit plus de trois fois de me faire payer autant d’argent que je veux. Mais j’ai mes raisons pour différer. Je vous dois environ 100 louis, l’autre moitié de la lettre a été payée pour des dettes d’Albert.
Hier Villers est venu chez moi; c’est un Allemand enragé, je suis débonnaire à côté de lui. Figurez-vous que M. Constant s’est laissé engager par sa bête de femme à aller à Brunswic et que, dans le moment intéressant, il ne se trouve pas à Göttingue. Aujourd’hui, je reverrai mon frère aîné, aussi bon patriote que moi. Je n’ai point encore de nouvelles de ma sœur, qui doit avoir passé de mauvais jours à Dresde, surtout ayant une maison. Mon beau-frère est tellement ardent pour la bonne cause qu’il est entièrement résigné sur son propre sort, qui dépend de celui du Roi de Saxe. Frédéric est resté à Vienne, mais il est en activité; il a fait plusieurs mémoires sur les affaires d’Allemagne pour le Ministre, à ce que celui-ci m’a dit lui-même.
Bonaparte a enfin rompu son silence sur notre Prince. Il a débuté par les plus infâmes invectives dans la gazette de Leipzig, 5 octobre, je ne sais pas si vous aurez vu cet article; j’y suis nommé honorablement sans doute, mais en assez mauvaise compagnie avec Kotzebue, Sarrazin et Goldsmith. J’ai fait une réponse en français qui s’imprime actuellement à Leipzig, vous l’aurez au plutôt; elle est faite pour être répandue en France. Les Danois continuent d’écrire contre moi en prose et en vers, en danois, en allemand et en français.
Je suis chargé à présent de faire imprimer les lettres et autres pièces interceptées par Czernicheff et nos autres partisans; car, outre quartier-maître général, ce diable de Czernicheff s’est fait aussi l’archiviste de Bonaparte. Cela est du plus grand intérêt et si j’avais ce sac de papiers en Angleterre il me vaudrait 500 livres sterling. Tous les mystères de la Police Générale y sont. J’espère qu’on me donnera de la latitude. Il y a une longue lettre de l’Impératrice à son mari; – celle-là est naturellement réservée – elle est plutôt faite pour inspirer de l’intérêt pour cette femme et pour son bambin de Rome, sauf sa tendresse pour le monstre. Cette lettre est du moins féminine, disait M. Thornton.
J’ai reçu ici une lettre fort spirituelle d’Auguste du 5 octobre. Je ne suis pas en état d’y répondre en ce moment. Je vous dirai seulement que je suis bien aise qu’il balance à l’égard de ses propres souhaits. Je n’aurais pas pu vous savoir seule pendant tout l’hyver, et si Aug[uste] eût voulu retourner, après 3 semaines de séjour au Quartier G[énéral], ç’aurait été vraiment rechercher la mauvaise raison. Je lui ai écrit tous les motifs pour la négative; mais en supposant qu’il eût reçu une réponse affirmative dans le plus court délai, il serait toujours arrivé après les batailles de Leipzig. A présent, on ne peut plus se flatter de voir de grands événemens dans cette campagne; il n’y a pas de quoi: pour voir de près détaler un Empereur, il faut être cosaque. Ensuite il aurait été fâcheux de faire une navigation longue et pénible, lorsque nos communications directes avec l’Angleterre vont se rouvrir en quinze jours peut-être. Figurez-vous qu’à Cöthen encore nous avons eu pendant un moment l’appréhension que nos communications avec la Suède seraient coupées temporairement. Je pourrais ajouter encore bien d’autres argumens pour vous convaincre qu’Auguste a bien fait de ne pas exécuter son projet. D’ailleurs, qui sait quand l’occasion de passer un hyver en Angleterre se retrouvera!
Et la chère Albertine a eu la rougeole! La pauvre enfant! J’espère que vous me donnerez bientôt la nouvelle de son entier rétablissement. J’ai si longtemps différé de lui écrire, que je ne sais plus faire une lettre assez distinguée pour réparer mes torts. Je dois aussi une réponse à M. Rocca.
Chère amie, je vous suis dévoué pour la vie entière; tout ce que le vois et éprouve, ce sont des matériaux pour nos soirées. Mais j’espère que le monde sera arrangé de façon à ce que vous pourrez choisir votre séjour, et vous n’aurez plus besoin de moi ennuyeux.
Mille amitiés.